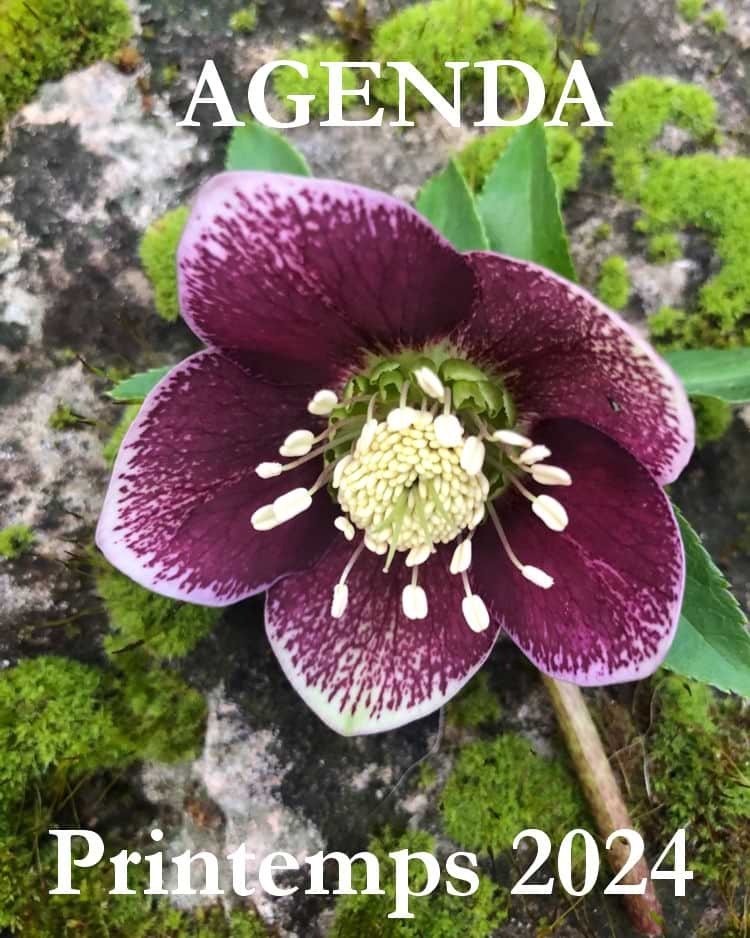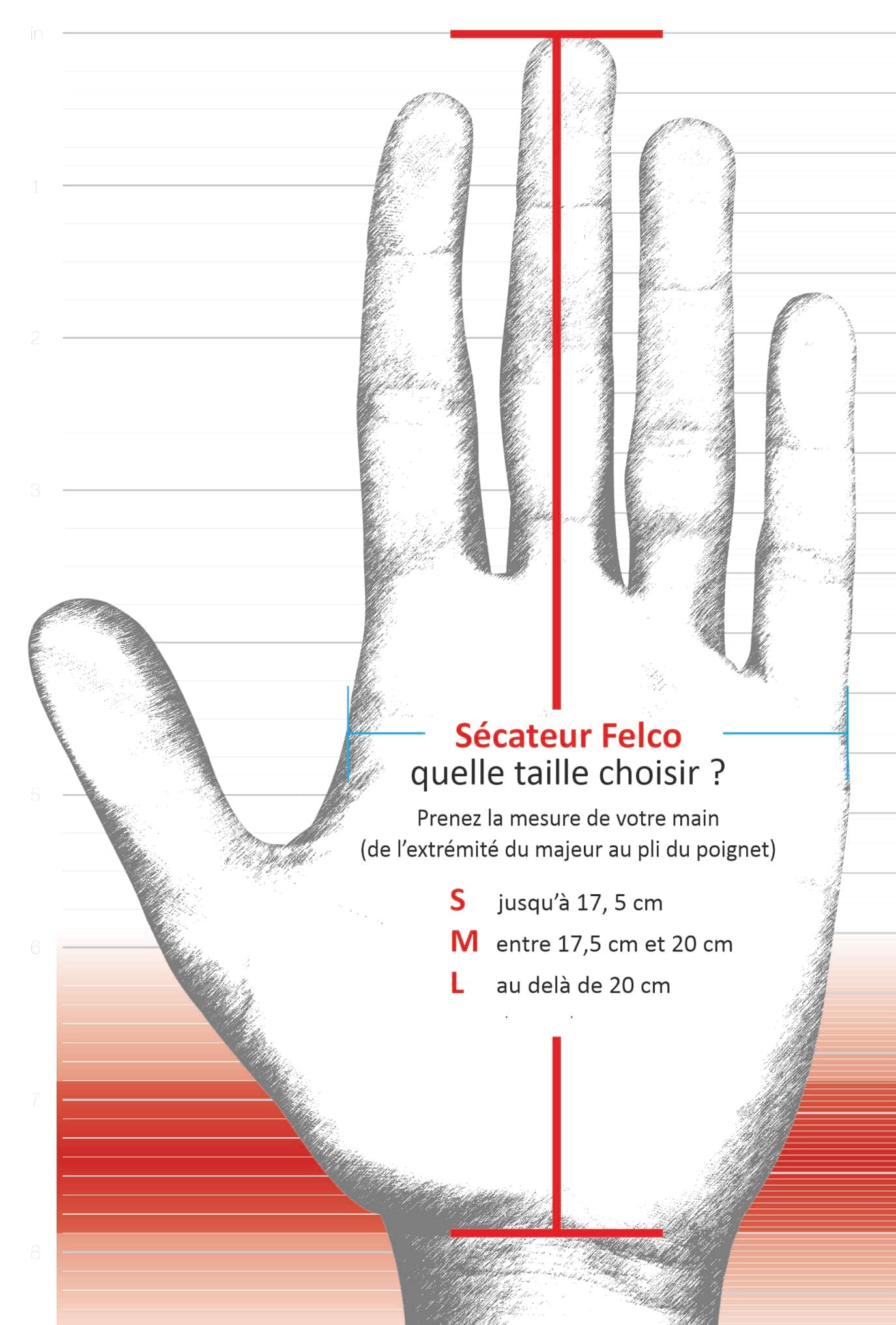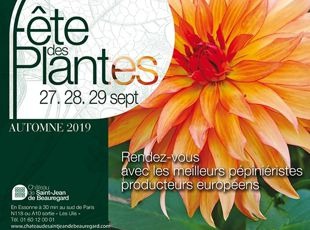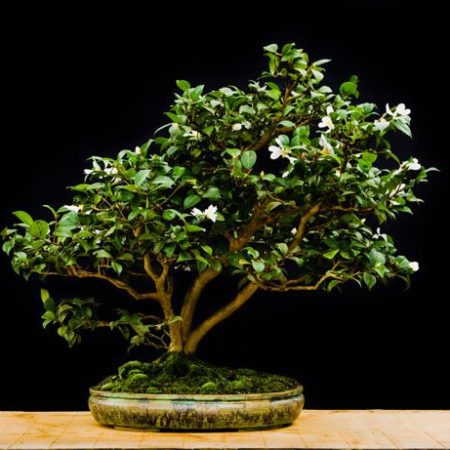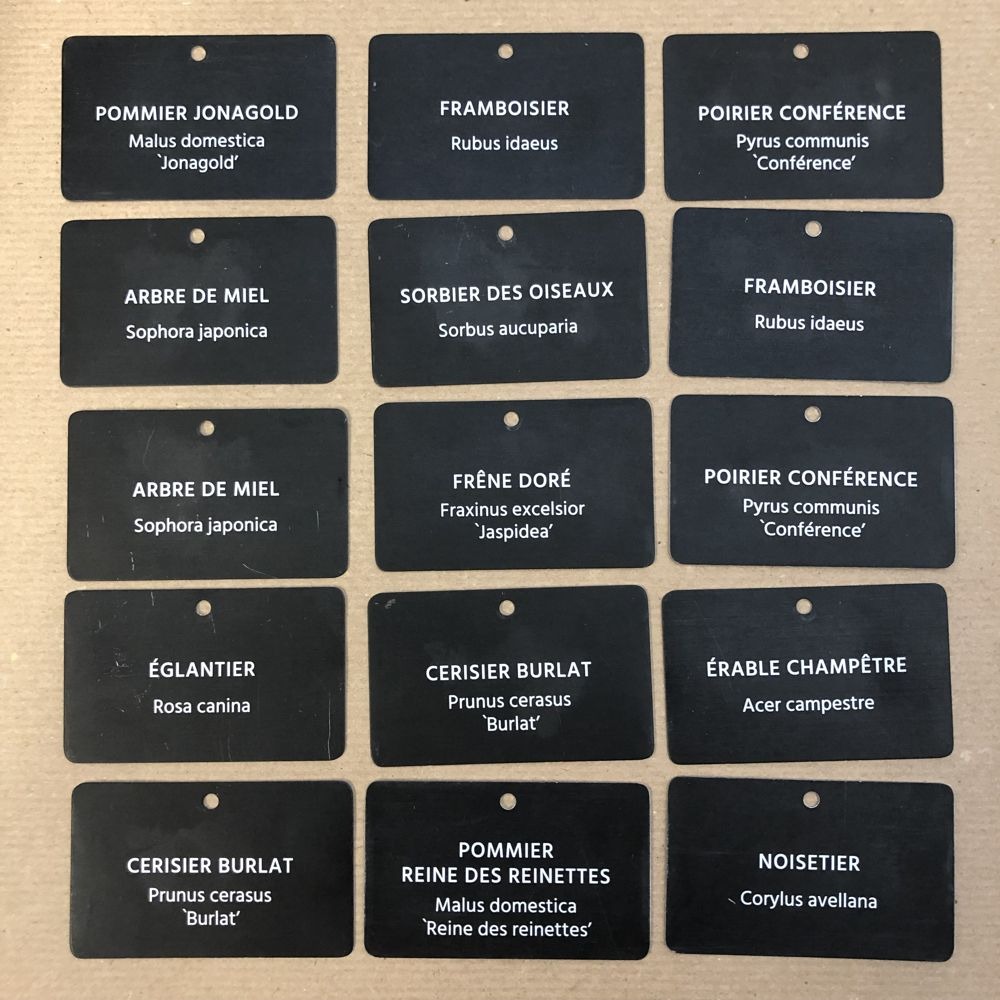Au jardin
En quelques dates pour se rencontrer et vous présenter nos produits
Fête des plantes
26, 27 & 28 avril 2024, profitez de notre service d'entretien offert pour votre sécateur Felco
Au jardin
Un magnolia caduque à grandes feuilles, floraison juin : Magnolia obovata
Au jardin
C’est en Auvergne, dans le département de la Haute-Loire, une tenture flamande du 16ème siècle désormais restaurée après 6 années de minutieux travaux.
Au jardin
Pour vous mettre sur la piste, voici quelques indices … Il est joyeusement passionné de jardin, de botanique, auteur et animateur de télévision. Il devient l'ambassadeur de Felco gamme de sécateurs qu'il connait bien et entreprise dont il partage les valeurs : solidité, précision et fiabilité!
Au jardin
Parmi un amas de broussailles, quelques perles de sang brillaient étrangement. Après avoir dégagé tout ce qui l’emprisonnait, un curieux petit rosier apparut, avec des hampes portant des grappes de petits boutons très fermés d’un rouge éclatant...
Au jardin
Deux grands rendez-vous en Île de France à noter dans votre calendrier de rentrée où nous pourrons nous rencontrer.